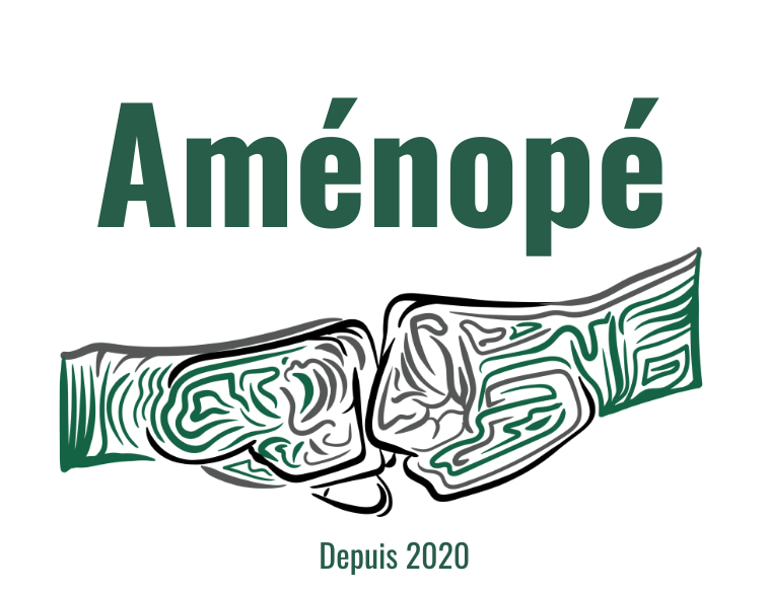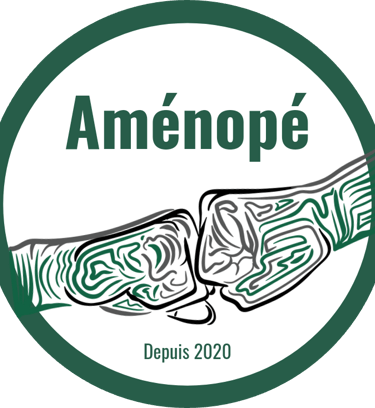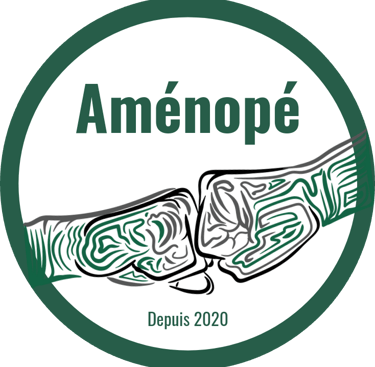OUVERTURE OFFICIELLE EN 2026
Sauvegarde des semences et pépinières tropicales : renforcer l’autonomie semencière au Togo
BIODIVERSITÉCULTURESEMENCESPÉPINIÈRE
Stéphane Walger


Semences : mémoire vivante et sécurité alimentaire
Le mot semence évoque bien plus que de simples graines : c’est un patrimoine génétique et culturel. Dans l’introduction du rapport « Les vrais producteurs de semences », GRAIN rappelle que l’agriculture est née lorsque les communautés ont commencé à collecter, planter et sélectionner des graines, et que les semences « incarnent des siècles de savoir sur la façon de les conserver, de les transformer, de les planter et de les guider vers une expression fructueuse »grain.org. Ce document souligne que c’est grâce à ces communautés locales que l’Afrique possède une diversité alimentaire exceptionnelle. Aujourd’hui encore, de nombreux paysans du Togo et d’Afrique de l’Ouest perpétuent ces pratiques : le rapport souligne que les petits agriculteurs, majoritairement des femmes, fournissent 80 à 90 % des semences plantées en Afrique subsaharienne et que ces « systèmes semenciers paysans », aussi appelés systèmes gérés par les agriculteurs, produisent des semences biodiverses et résilientes capables de s’adapter aux changements climatiques. Les semences paysannes sont fiables, disponibles et abordables ; elles sont stockées localement et ne nécessitent aucun achat.
En revanche, l’industrialisation de l’agriculture a provoqué une érosion dramatique de cette diversité. L’article Seed Saving 101 rappelle qu’environ 93 % des variétés de semences ont disparu au cours du siècle dernier en raison de l’agriculture industrielle et de la mainmise des multinationales ; quatre entreprises contrôlent désormais 60 % des ventes mondiales de semences. Seuls 12 plantes et 5 espèces animales constituent 75 % de l’alimentation mondiale. La concentration sur quelques cultures rend nos systèmes alimentaires plus vulnérables aux maladies et au climat. C’est pourquoi la souveraineté semencière — le droit de conserver, d’échanger et de vendre ses propres semences — est devenue un enjeu crucial
Préserver les semences : gestes techniques
Sélection des plantes mères : pour conserver un trait génétique, on choisit les plantes les plus saines, les plus vigoureuses et adaptées aux conditions locales (sécheresse, chaleur, maladies). Par exemple, on laissera monter en graine les plus belles laitues ou sorghos robustes, et on marquera les plants à conserver.
Récolte au bon moment : les graines doivent être récoltées à maturité. Pour les graminées (mil, maïs, sorgho), on attend le dessèchement complet des épis. Pour les légumes-fruits (tomate, piment), on récolte les fruits bien mûrs avant de les ouvrir pour extraire les graines.
Nettoyage et tri : on élimine les débris végétaux, les graines vides ou abîmées en les vannant ou en les tamisant. L’utilisation de l’eau permet de séparer les graines lourdes (qui coulent) des graines stériles (qui flottent).
Séchage : les graines doivent être bien sèches avant stockage pour éviter la moisissure. On les étale en couche mince dans un endroit ventilé et à l’ombre pendant plusieurs jours. Une astuce consiste à ajouter du charbon ou du riz sec dans les bocaux pour absorber l’humidité.
Stockage : les graines se conservent dans des contenants hermétiques (bocaux en verre, sachets kraft) placés dans un lieu frais et sec. Certaines communautés placent les graines dans des calebasses enterrées pour bénéficier d’une température stable. On étiquette chaque lot (espèce, variété, date de récolte) pour suivre la rotation.
Ces pratiques ne sont pas seulement agronomiques : elles sont culturelles. L’article d’EcoWatch souligne que la sauvegarde des semences est pratiquée depuis des millénaires par des communautés autochtones non seulement pour l’alimentation mais aussi pour des raisons sociales et culturelles. Elle constitue un investissement pour les récoltes futures et un fil conducteur pour la sécurité alimentaire et la préservation des cultures.
Concevoir et gérer une pépinière tropicale
Pour multiplier les arbres fruitiers, les plantes vivaces et produire des plants sains pour la reforestation, il est utile de créer une pépinière. Le Guide de gestion des pépinières du projet Re‑greening Africa définit la pépinière comme un site géré pour produire des jeunes plants « sous des conditions favorables jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être plantés en champ, en forêt ou dans des zones communautaires »regreening. Le même document explique qu’en Afrique l’épuisement des sources naturelles de jeunes plants et la demande croissante en arbres entraînent un manque de plants diversifiés ; créer des pépinières permet de répondre à cette demande tout en générant des revenus pour les agriculteurs.
Types de pépinières
Le guide distingue deux catégories : pépinières temporaires et pépinières permanentes. Les temporaires fonctionnent une saison pour répondre à un programme de plantation (reboisement, campagne de distribution) et produisent quelques espèces, souvent exotiques. Les pépinières permanentes, quant à elles, fonctionnent plusieurs années, disposent d’une infrastructure plus solide (réserve d’eau, zones d’ombrage, stockage de substrat) et proposent une large gamme d’espèces indigènes et d’arbres greffés. À la ferme Aménopé, une pépinière permanente produit des plants de moringa, de papayiers et de cacaoyers greffés qui sont vendus aux agriculteurs locaux.
Choisir un bon site
Un bon emplacement est essentiel pour la réussite d’une pépinière. Le guide recommande de s’installer à proximité d’une source d’eau fiable, sur un terrain légèrement en pente pour un bon drainage, avec un sol fertile et bien drainé, un accès facile pour transporter les plants et suffisamment de lumière tout en étant à l’abri du ventre. On évitera les sols argileux, les zones marécageuses ou les sommets exposés. Des arbres brise-vent, des clôtures ou des haies peuvent protéger la pépinière des animaux et des intrusions. Une organisation logique des allées et des zones (lit de germination, zone de rempotage, aire de stockage, compostage) facilite les tâches quotidiennes
Pratiques de base
Substrat : un mélange léger et drainant à base de terre de jardin (2 parts), de compost mûr (1 part) et de sable de rivière (1 part) convient pour la plupart des semis tropicaux. On peut ajouter un peu de charbon de bois broyé pour améliorer la rétention en nutriments.
Semis et repiquage : on sème finement les graines dans des bacs ou sur des planches surélevées. Lorsque les plantules ont 2–3 feuilles, on les repique dans des pots (sachets en polyéthylène ou pots biodégradables). Cette opération s’appelle le pricking‑out et favorise un système racinaire robuste.
Ombrage et arrosage : les jeunes plants nécessitent un ombrage léger (filet d’ombrage ou toiture en paille) pour éviter les brûlures. L’arrosage doit être régulier mais modéré pour éviter la pourriture des racines ; on privilégiera des arrosoirs à pomme fine.
Désherbage et hygiène : on désherbe régulièrement pour éviter la compétition et on élimine les plants malades. Le guide insiste sur l’importance de contrôler les mauvaises herbes car elles peuvent héberger des insectes et des pathogènes. On nettoie les allées et on brûle les débris infestés.
Durcissement : quelques semaines avant la transplantation en plein champ, on réduit progressivement l’irrigation et l’ombrage afin d’habituer les plants aux conditions extérieures.
Le rôle des communautés et des femmes
Les semences paysannes ne survivent que grâce à l’engagement des communautés. Le rapport de GRAIN rappelle que les femmes sont les principales gardiennes des semences en Afrique et que leurs connaissances sont peu reconnues Dans de nombreux villages togolais, les femmes sélectionnent, stockent et échangent les semences de mil, de riz africain et de haricot niébé. Les banques de semences communautaires, où les paysans déposent et empruntent des semences selon leurs besoins, favorisent cet échange. Elles permettent de préserver les variétés locales et constituent une réserve en cas de perte de récolte.
Conclusion
Préserver et multiplier les semences au Togo n’est pas seulement une question de nostalgie ; c’est un acte stratégique pour l’autonomie alimentaire et la résilience face au changement climatique. En apprenant à sélectionner, conserver et échanger les graines, et en installant des pépinières bien conçues, les agriculteurs s’assurent un patrimoine vivant qui continuera de nourrir les communautés. La ferme Aménopé montre qu’un tel effort est compatible avec une agriculture innovante : elle sélectionne et vend des plants adaptés tout en valorisant les semences paysannes. Face à l’expansion des semences industrielles, maintenir cette diversité constitue un acte de résistance et de créativité, indispensable à l’agroécologie en Afrique de l’Ouest.
Autres articles de Blog :
Aménopé Togo
Prendre soin des Humains
CONTACT / RESERVATIONS
Tél : +228 92 67 00 00
Association Aménopé Togo - Récépissé n° 0568/MATDCL/SG/DLPAP/2025 - All rights reserved. © 2025.
RECEVOIR LA NEWSLETTER / LES EBOOKS
Ferme Aménopé Togo
Quartier SOSSI
Agou-Nyogbo Sud
Kloto, Togo
Aménopé est une micro-ferme permacole en polyculture et élevage située à Agou-Nyogbo, au pied du Mont Agou, dans la région des Plateaux au Togo.
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
Vous êtes déjà venu(e) à la Ferme Aménopé 🤍
Vous avez planté une bouture, partagé un repas, suivi un stage ou simplement pris une grande bouffée d’air pur au cœur de notre jardin-forêt
VOUS !